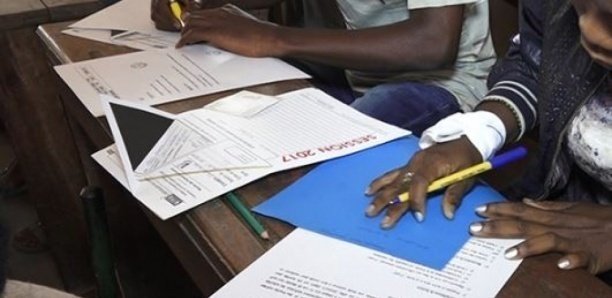SUJET III : DISSERTATION
Mario Varga Llosa déclarait dans son discours de réception du prix Nobel en 2010 : « La littérature est une représentation fallacieuse de la vie, qui, néanmoins, nous aide à mieux la comprendre… »
En vous appuyant sur vos lectures, vous montrerez que l’écrivain ne reproduit pas seulement la vie, mais il la recrée avec ses propres moyens pour mieux nous l’expliquer.
Correction de ce sujet
ChatGPT a dit :
Voici une correction rédigée pour ce sujet de dissertation :
Introduction
La littérature, en tant qu’art du langage, a toujours eu pour vocation de représenter la vie, de la transfigurer ou de l’interroger. Dans son discours de réception du prix Nobel en 2010, Mario Vargas Llosa déclarait : « La littérature est une représentation fallacieuse de la vie, qui, néanmoins, nous aide à mieux la comprendre… » Par cette formule, l’écrivain souligne le paradoxe de la littérature : elle n’est pas un reflet fidèle de la réalité, mais c’est précisément en la recréant qu’elle nous éclaire sur elle. Ainsi, il s’agit de se demander en quoi l’écrivain ne se limite pas à reproduire la vie telle qu’elle est, mais la recrée avec ses propres moyens pour mieux nous l’expliquer.
Nous montrerons d’abord que l’écrivain dépasse la simple imitation du réel, puis que, par des procédés spécifiques, il construit une vision nouvelle du monde, et enfin que cette recréation éclaire et approfondit notre compréhension de la condition humaine.
I. La littérature : une représentation transformée de la vie
La littérature ne copie pas la vie de manière exacte : elle sélectionne, organise, exagère, simplifie ou symbolise des aspects du réel.
→ Exemple : Dans Les Misérables de Victor Hugo, l’auteur ne se contente pas de décrire la misère : il choisit des personnages exemplaires (Jean Valjean, Fantine) pour incarner le drame social et moral.
→ L’écrivain use de la fiction : il crée des intrigues, des personnages et des dialogues qui n’ont jamais existé, mais qui permettent de révéler des vérités plus profondes que la simple réalité brute.
→ Par le style, la subjectivité de l’écrivain s’impose : un roman réaliste, un poème lyrique ou une fable morale construisent chacun une vision particulière.
II. L’écrivain recrée le monde selon sa sensibilité et ses choix artistiques
Chaque écrivain réinvente la vie à travers son imaginaire, ses idées, ses émotions et ses techniques d’écriture.
→ Exemple : Dans L’Étranger d’Albert Camus, la vie est représentée à travers la conscience étrange et détachée de Meursault, donnant une image déformée mais révélatrice de l’absurdité de l’existence.
→ La littérature exploite des procédés : métaphores, symboles, structure narrative, point de vue, registre de langue. Ces outils créent un monde qui n’est pas celui de la vie ordinaire mais un monde littéraire.
→ Les genres littéraires eux-mêmes recréent la vie : l’utopie (L’Utopie de Thomas More), la dystopie (1984 de George Orwell), le conte philosophique (Candide de Voltaire).
III. Une recréation qui éclaire la vie et aide à mieux la comprendre
Cette recréation permet au lecteur de prendre du recul, de réfléchir et de saisir des aspects de la vie qu’il n’aurait pas perçus autrement.
→ La littérature, par sa liberté de recréation, suscite l’émotion et la réflexion.
→ Exemple : La Peste de Camus offre une image fictive d’une épidémie mais permet de comprendre la solidarité humaine, le courage et la résistance face au mal.
→ Les écrivains révèlent ce qui est caché dans le réel : la psychologie humaine, les injustices sociales, les mécanismes du pouvoir, les contradictions intérieures des hommes.
Conclusion
La littérature, bien qu’elle offre une représentation fallacieuse de la vie, recrée le réel pour mieux en dévoiler les secrets. Loin d’être un simple miroir, elle est un prisme qui, en transformant le monde, nous aide à mieux le comprendre. Comme l’affirmait Vargas Llosa, cette illusion littéraire est un chemin vers la vérité humaine.